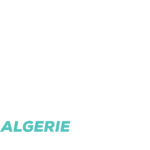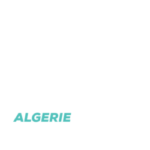C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Fadéla M’Rabet née Abada, survenu ce matin, mercredi 14 mai 2025, à Paris. Figure emblématique du féminisme algérien, docteure en biologie, enseignante, écrivaine et militante, elle laisse derrière elle un héritage intellectuel et humaniste qui continuera d’inspirer des générations. Née en 1935 à Skikda, en Algérie, Fadéla M’Rabet a marqué son époque par son combat acharné pour l’émancipation des femmes et contre les dérives de l’intégrisme machiste et religieux.
Une enfance singulière à Skikda
Fadéla M’Rabet voit le jour dans une famille algérienne progressiste de Skikda, une ville côtière baignée par la Méditerranée. Son père, lettré formé à l’institut islamique d’Al Zeitouna en Tunisie, est un homme éclairé, membre du mouvement oulémiste prônant un Islam réformiste et ouvert. Il est le premier à Skikda à envoyer ses filles à l’école, bravant les conventions sociales de l’époque. Sa grand-mère, « Djedda Djemaa », accoucheuse respectée et figure d’indépendance, joue également un rôle déterminant dans la formation de la jeune Fadéla. Mariée à 14 ans et veuve à 26, « Djedda Djemaa » refuse de se remarier, incarnant une femme libre et maîtresse de son destin.
C’est dans ce milieu familial, imprégné de tolérance et de rationalisme, que Fadéla M’Rabet forge son identité. Ses souvenirs d’enfance, qu’elle décrira avec une plume poétique et sensible dans des ouvrages comme Une enfance singulière (2003) et Le Muezzin aux yeux bleus (2008), révèlent un environnement mystique et harmonieux, où les senteurs, les rituels et la spiritualité d’un Islam tolérant marquent son imaginaire. Ces années fondatrices nourriront son engagement contre l’intolérance et les interprétations rétrogrades de la religion.
Une carrière académique et un militantisme précurseur
En 1954, Fadéla M’Rabet part à Strasbourg pour poursuivre des études supérieures en sciences. Elle y obtient un doctorat en biologie, une prouesse pour une femme algérienne de cette époque. De retour en Algérie en 1962, après l’indépendance, elle épouse Maurice Maschino, militant français pour la cause algérienne, et enseigne les sciences naturelles dans des lycées d’Alger. Parallèlement, elle anime, avec son mari, des émissions radiophoniques sur la Chaîne III, abordant des thèmes comme la jeunesse, l’histoire africaine et la littérature.
Dès 1965, Fadéla M’Rabet se distingue par la publication de La Femme algérienne (Maspero), suivi en 1967 par Les Algériennes. Ces essais, parmi les premiers à analyser la condition des femmes dans l’Algérie post-indépendance, dénoncent avec audace le patriarcat et les privilèges masculins, y compris au sein du FLN, où les militantes sont marginalisées après la guerre. Ces écrits, jugés subversifs par le régime d’Houari Boumédiène, lui valent une interdiction d’enseigner et d’accès aux médias. En 1971, contrainte à l’exil, elle s’installe à Paris, où elle devient maître de conférences et praticienne hospitalière à Broussais-Hôtel-Dieu.
Une plume au service de la mémoire et de la justice
Installée en France, Fadéla M’Rabet poursuit son œuvre littéraire et son engagement. Ses écrits, mêlant autobiographie, essai et poésie, explorent la nostalgie de son enfance algérienne, la triple aliénation du peuple algérien (patriarcat, colonialisme, pouvoir postcolonial) et les manipulations politiciennes de l’Islam. Parmi ses ouvrages marquants figurent L’Algérie des illusions (1972, en collaboration avec Maurice Maschino), Une femme d’ici et d’ailleurs (2005), Le chat aux yeux d’or (2006), Alger, un théâtre des revenants (2010), Le café de l’imam (2011) et La salle d’attente (2013).
Son livre Le Muezzin aux yeux bleus (2008, Riveneuve Éditions) est particulièrement révélateur de sa sensibilité. Ce récit autobiographique retrace l’éducation morale d’une petite fille dans un milieu arabo-islamique éclairé, sous l’influence de trois figures : son père, modèle de rationalisme et de bilinguisme ; le muezzin, dont la voix poétique l’initie à la beauté de l’arabe littéraire ; et son institutrice française, symbole d’ouverture culturelle. Avec une langue sensuelle et précise, Fadéla M’Rabet y célèbre la fusion harmonieuse de ses deux cultures, loin des déchirements identitaires.
Un cri du cœur pour les femmes algériennes
Fadéla M’Rabet n’a cessé de dénoncer les injustices subies par les femmes algériennes, souvent justifiées par des lectures déformées du Coran. Dans ses écrits, elle oppose l’Islam tolérant de son enfance, incarné par ses parents et sa grand-mère, à l’intégrisme qui aliène les femmes sous couvert de religion. Ses commentaires, empreints de colère et d’espoir, sont des appels à l’éducation et à l’émancipation, offrant aux femmes un modèle d’Islam humaniste et progressiste.
Son dernier ouvrage, Le Muezzin aux yeux bleus, publié récemment aux éditions Rive Neuve, résonne comme un testament spirituel. À travers une prose romantique et engagée, elle invite les lecteurs à redécouvrir une Algérie harmonieuse, avant que des manipulations politiciennes ne la conduisent vers l’intégrisme. Ce livre, riche en expériences vécues, est une ode à la tolérance et un plaidoyer pour un avenir où les femmes algériennes seraient libérées des jougs patriarcaux.
Un héritage intemporel
Le décès de Fadéla M’Rabet laisse un vide immense dans le paysage intellectuel et militant algérien. Première féministe algérienne, elle a ouvert la voie à une réflexion critique sur la condition féminine et sur les dérives de l’intégrisme. Sa vie, partagée entre Skikda, Alger, Strasbourg et Paris, incarne un pont entre les cultures, un refus des cloisonnements et une quête inlassable de justice.
Son œuvre, accessible à un large public, continuera d’éclairer les consciences, rappelant que l’Algérie, comme elle l’écrivait, fut un jour un creuset de tolérance et de diversité. À travers ses mots, Fadéla M’Rabet nous lègue un message d’espoir : celui d’un Islam éclairé, d’une égalité entre les genres et d’une société libérée des aliénations. Elle repose désormais en paix, mais ses idées et sa voix résonneront encore longtemps.