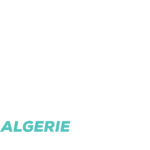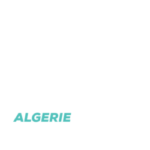Ousmane Boundaoné est consultant pour le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), responsable des programmations, directeur administratif de Génération Films et coordinateur général du Ouaga Film Lab.
Rencontré lors d’une table ronde consacrée aux festivals et à la distribution des films africains, en marge du Festival international du court métrage de Timimoun, il revient sur les obstacles à la circulation des œuvres sur le continent, le rôle des festivals et l’urgence de reconstruire un réseau solide en Afrique.
Pourquoi la circulation des films africains reste-t-elle aussi limitée sur le continent, malgré une production en pleine effervescence ?
L’instabilité politique joue un rôle, mais ce n’est pas la cause principale. Le véritable problème, c’est le manque de transmission et de partage des acquis. Pendant des années, l’Occident a attiré les cinéastes africains sans vraiment consolider le travail sur le continent. Résultat : notre imaginaire nous échappe, et nos films circulent très mal chez nous. Il manque des écrans, des salles, des circuits fiables.
Nous n’arrivons même pas à montrer nos films chez nous : voir un film africain en Afrique relève encore du défi. Le premier travail, c’est celui des compétences : quand les professionnels sont bien formés, ils circulent, ils franchissent les obstacles politiques et économiques.
En Afrique comme en Europe, quelle place occupent aujourd’hui les festivals dans la visibilité et la diffusion du cinéma africain ?
Ils jouent un rôle essentiel : ils offrent des écrans. Cela peut sembler anecdotique, mais c’est tout sauf insignifiant. Sembène Ousmane parlait du cinéma comme de « l’école du soir », un lieu de transmission. Le cinéma doit retrouver cette fonction.
Les festivals sont des espaces où l’on apprend à se reconnaître, à s’accepter, à regarder nos propres récits. Ils créent l’existence même de ces histoires. C’est pour cela que je soutiens ce festival de Timimoun : chaque écran gagné est une victoire.
Peut-on dire que les festivals africains ont aujourd’hui réussi à affirmer une identité propre ?
On s’en approche. Beaucoup sont pilotés par des professionnels qui orientent la programmation et savent quelle image proposer à leur public. Connaître son public, c’est déjà construire une identité.
Cette identité se définit aussi par les choix éditoriaux : documentaire, animation, fiction, court métrage… Chaque orientation donne une couleur particulière. Le FESPACO, par exemple, a une identité forte : c’est un festival d’auteur, où l’Étalon d’or récompense un regard singulier.
Quelles initiatives permettent réellement de faire circuler les films africains, sur le continent comme à l’international ?
Avant de penser à l’international, je pense à l’Afrique. Nous manquons d’écrans, de salles, de festivals. Nous ne sommes pas vus chez nous. Cela ne signifie pas qu’il faut opposer Afrique et Occident : il faut progresser sur les deux terrains. Mais la priorité reste le continent.
Je me réjouis de voir l’Algérie investir dans des festivals au sud et au centre du pays. C’est ainsi que les choses évolueront : chaque pays doit faire ce pas-là. Plus nous nous regarderons nous-mêmes, plus l’unité africaine se construira naturellement.