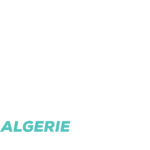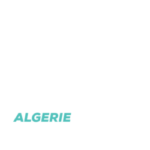À l’occasion du 20ᵉ anniversaire des Rencontres cinématographiques de Béjaïa (RCB), 24H Algérie a rencontré leur fondateur, Abdenour Hochiche. Architecte de cet espace unique de liberté artistique et de création, il revient sur la genèse du festival, son rôle dans le paysage culturel algérien et les raisons de sa longévité malgré des moyens limités.
24H Algérie: Les Rencontres cinématographiques de Béjaïa fêtent cette année leur 20ᵉ anniversaire. Que ressentez-vous en voyant cette aventure atteindre une telle longévité ?
Abdenour Hochiche: Je ressens avant tout de la fierté, la fierté de voir qu’un événement lancé presque dans l’indifférence générale en 2003 est aujourd’hui inscrit dans le paysage cinématographique national, et même régional. Mais je ressens aussi une certaine frustration, car à mon avis, ces rencontres auraient pu connaître un essor plus important si tous les éléments avaient concouru à leur réussite.
Vous êtes considéré comme l’architecte principal de cette manifestation, qui reste l’une des plus anciennes plateformes consacrées au cinéma en Algérie. Quelle vision portiez-vous au moment de sa création ?Il faut d’abord préciser que nous étions une poignée à croire en ce projet. Puisque l’occasion m’est donnée, je tiens à citer celles et ceux qui étaient présents au tout début, lorsque nous avons commencé à réfléchir à organiser une manifestation autour du cinéma : Lamine Blidi, Samir Abdelbost et Karim Hamoudi. Je n’oublie pas non plus Habiba Djahnine et l’association Kaïna Cinéma, avec lesquels nous avons travaillé sur les quatre premières éditions.
Au départ, nous voulions tout simplement doter Béjaïa d’un rendez-vous annuel autour du cinéma. Une idée assez classique. Mais au fil du temps, notre réflexion a mûri, jusqu’à donner naissance à une manifestation atypique dans le paysage cinématographique algérien. L’identité des RCB s’est construite en même temps que nous nous construisions nous-mêmes.
Quelles étaient les motivations profondes qui vous ont conduit à lancer les RCB et, deux décennies plus tard, que représentent-elles pour vous sur le plan personnel et artistique ?
Le début des années 2000 a été une période de renaissance culturelle et artistique après les affres des années 90. Nous voulions prolonger cette renaissance à travers une plateforme de rencontres, de débats et de réflexions autour du cinéma algérien et du cinéma en Algérie. Il s’agissait aussi d’accompagner une nouvelle génération de cinéastes qui n’avait ni lieu, ni espace de rendez-vous pour montrer ses films, rencontrer ses pairs et dialoguer avec le public.
Sur le plan personnel, cette aventure m’a permis de mûrir et de mieux comprendre les enjeux sociétaux que peut porter l’art en général. Le cinéma est une nécessité, et c’est la plus belle des nécessités, car elle emprunte un véhicule à la fois artistique et esthétique.
En 20 ans, le cinéma algérien a traversé plusieurs cycles, entre périodes fastes et moments de creux. Comment analysez-vous l’état actuel du cinéma national, et quelle place les RCB y occupent-elles ?
Effectivement, le cinéma algérien a connu des hauts et des bas. Ce mouvement n’a rien d’inquiétant en soi, à condition de l’analyser et de le comprendre en profondeur avant d’essayer de le faire évoluer. Nous sommes une société en pleine mutation à tous les niveaux, et le cinéma, comme les autres arts, en subit les effets. C’est à lui d’ingurgiter ces mutations, de transformer ces flux et reflux, et de les rendre d’une manière artistique et novatrice.
Dans ce contexte, les RCB doivent continuer à jouer le rôle qu’elles se sont assignées dès le début : préparer un terrain fertile pour que le débat autour du cinéma puisse se dérouler dans la sérénité et l’apaisement.
Malgré un financement limité, les Rencontres ont réussi à s’imposer comme un rendez-vous incontournable. Selon vous, quel a été le moteur de cette longévité et qu’est-ce qui fait la singularité des RCB par rapport à d’autres festivals ?
L’argent est important, bien sûr, mais au-delà, il y a l’envie et la passion. Les RCB ont toujours avancé grâce à ces deux moteurs. Il faut aussi parler de ce sentiment d’attente que l’on lit sur les visages du public et des professionnels, impatients de la prochaine édition dès que la précédente se termine. Cette attente est une motivation supplémentaire. Elle nous pousse à inventer et à nous réinventer, à compenser le manque de moyens financiers par d’autres ressources : l’adhésion d’une ville entière, le soutien des partenaires et la fidélité d’un public qui a porté cette manifestation dès le début. C’est sans doute là que réside la singularité des RCB : une identité forte, un ancrage solide et une confiance mutuelle entre les rencontres et celles et ceux qui les entourent.
Les RCB se distinguent aussi par leur dimension humaine et leur ouverture aux jeunes cinéastes. Était-ce un choix assumé dès le départ, et comment cela a-t-il façonné l’identité du festival ?
Dans l’art en général, la dimension humaine doit primer. Qu’est-ce que le cinéma, sinon une affaire de femmes et d’hommes, de sensibilité, de subtilité et de rêve ? Les RCB ont intégré cette dimension dès leurs débuts. Dès les premières éditions, nous avons veillé à rester « à hauteur humaine », pour permettre à chacun de trouver sa place. Les jeunes arrivant avec leurs premiers films pouvaient ainsi rencontrer leurs aînés, tisser des liens et prolonger le récit collectif. C’est ce qui fait la particularité des RCB : un espace sans protocole, ouvert à toutes et à tous.
Au-delà de l’organisation, quelles sont les anecdotes ou souvenirs les plus marquants qui vous reviennent en repensant aux premières éditions ?
Il y en a beaucoup. Des rencontres inoubliables avec nos aînés, comme Bouamari, Tsaki, Vautier, Clément, Djamila Sahraoui, Beloufa… La découverte de nouveaux visages comme Karim Moussaoui, Lakhdar Tati, Yasmine Chouikh, Yanis Koussim, et bien d’autres. Et surtout la joie de voir le bonheur se dessiner sur le visage du public.
Les premières éditions ont été difficiles à monter, mais elles avaient une saveur particulière. Avec le recul, on se souvient surtout des visages et des moments de joie. Je profite de cette question pour rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés, mais qui nous ont soutenus dans nos débuts.
Revenons à vos débuts : avant le cinéma, il y avait le théâtre. En quoi cette expérience a-t-elle nourri votre approche artistique et influencé votre manière d’accompagner le cinéma ?
J’ai toujours coutume de dire que Béjaïa est une ville de théâtre avant tout. Beaucoup d’animateurs culturels ont été formés dans l’effervescence théâtrale des années 80 et 90. Nous n’y avons pas échappé, et heureusement. Le théâtre a aiguisé en nous un regard artistique, esthétique et critique, qui nous a beaucoup aidés par la suite. Il nous a aussi permis de comprendre les enjeux culturels, ce qui a été essentiel lorsque nous avons lancé les RCB et leur avons donné une dimension qui leur a permis de survivre aux tempêtes.
Quels rêves ou perspectives nourrissez-vous aujourd’hui pour les RCB et pour le cinéma algérien en général ?
Pour les RCB, je rêve de voir cette belle manifestation se perpétuer et connaître un essor encore plus grand, compte tenu de son potentiel. Je souhaite qu’elles restent un incubateur de talents, un lieu où l’on vient sans savoir ce qui nous attend, mais avec la certitude de vivre une expérience, d’être ébloui, d’être bousculé par une projection, un débat ou une rencontre apparemment anodine. Je rêve que les RCB continuent d’être un espace d’intranquillité artistique.
Pour le cinéma algérien, je fais le vœu que le public et le cinéma se retrouvent chaque jour autour d’images et de sons, dans des salles accessibles à chaque quartier de notre vaste pays.