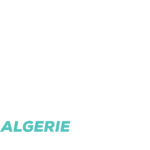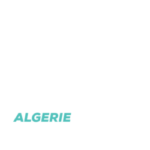L’ONU est-elle encore capable de répondre aux défis géopolitiques actuels ? Anne-Cécile Robert, journaliste, spécialiste des institutions internationales et membre du comité de rédaction du Monde diplomatique, a publié en octobre dernier Le défi de la paix : Remodeler les organisations internationales. Éclairé par des observations de terrain et des années de réflexion, cet essai permet de comprendre la crise actuelle de l’ordre international et ses enjeux profonds.
Dans cet entretien accordé à 24H Algérie, Anne-Cécile Robert dresse un bilan critique du rôle des organisations internationales face aux tensions croissantes. Entre efficacité humanitaire et blocages politiques, elle explore les défis du multilatéralisme et les pistes pour réformer l’ordre mondial.
24H Algérie: À la lumière des débats sur l’efficacité et l’impartialité des institutions internationales, comment évaluez-vous le rôle de l’ONU et des organisations affiliées face à la montée des tensions géopolitiques actuelles ? Pensez-vous qu’elles disposent encore des moyens pour arbitrer les crises mondiales de manière équitable ?
Anne-Cecile Robert: Les organisations internationales sont présentes dans pratiquement toutes les crises internationales, de l’Ukraine au Soudan en passant par la Birmanie ou le Proche-Orient. Le programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), notamment, agissent au quotidien partout dans le monde et sauvent des vies. De ce point de vue, elles sont efficaces et utiles. En revanche, concernant les crises qui impliquent les grandes puissances – Ukraine, Gaza, Syrie – leur rôle politique est cependant limité par l’abus du droit de véto de la part de Moscou et de Washington en particulier qui empêchent l’adoption de plans diplomatiques de sortie de crise. Les instances de l’ONU – l’Assemblée générale de l’ONU, la Cour internationale de justice (CIJ) et le Secrétaire général de l’ONU – ne se laissent pas intimider par cette attitude fautive : elles rappellent avec constance et force le droit international et apportent leur soutien aux populations victimes d’exactions. C’est primordial au moment où certains veulent faire dire au droit le contraire de ce qu’il dit en inventant des principes qui n’existent pas ou en tordant cyniquement leur sens. Notons aussi que le comportement fautif des grandes puissances n’empêche pas les pays du Sud, notamment en Afrique et en Amérique latine, d’investir les organisations mondiales pour en faire des tribunes et promouvoir des causes d’intérêt général. Cette dynamique constructive peut faire avancer la cause de la paix et redonner son indispensable rôle pacificateur à l’ONU. On constate ainsi que certaines grandes puissances, comme les Etats-Unis, sont désormais parfois sur la défensive dans les instances internationales. Washington a par exemple renoncé à présenter sa candidature au Conseil des droits de l’homme de l’ONU au printemps par peur de ne pas être élu et donc d’être désavoué. Cet événement est lié à la réprobation internationale du comportement adopté par les Etats-Unis dans le conflit à Gaza.
La CPI a récemment pris des décisions importantes notamment sur la poursuite de Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Les puissances censées protéger le droit ont pris des positions indignes. La France considère même que le mis en cause bénéficie de l’« immunité ». Cette déclaration sape-t-elle irrémédiablement l’autorité de la CPI ?
Les mandats d’arrêts émis par la CPI contre les dirigeants israélien (et un dirigeant du Hamas) montrent le souci de cette Cour d’agir de manière impartiale. Après l’inculpation de Vladimir Poutine, elle incrimine des alliés de l’Occident. La CPI renforce ainsi sa crédibilité alors qu’elle avait échoué à poursuivre les crimes de l’armée américaine en Afghanistan. En ce sens, la CPI progresse en cohérence et donc en crédibilité. En revanche, certains pays européens, pourtant champions historiques de la justice internationale, se contredisent désormais par souci de protéger leur allié israélien. La France a ainsi reconnu, à tort, aux dirigeants israéliens une immunité diplomatique et politique qu’elle a refusé quelques mois plus tôt à Vladimir Poutine. Cette attitude contradictoire et opportuniste de Paris sape sa parole internationale et pourrait limiter l’efficacité de la CPI. Mais il n’en reste pas moins que ces mandats créent une pression sur les dirigeants israéliens et compliquent leurs relations internationales. De nombreux pays de la planète accordent toujours leur confiance à la CPI et la loi du nombre peut finir par peser sur un Occident affaibli moralement.

Votre livre évoque les batailles d’influence qui se jouent au sein des organisations internationales. Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever par les pays du Sud pour réduire l’instrumentalisation de ces institutions par les grandes puissances et rétablir leur crédibilité fortement ébranlée ?
Les grandes puissances, notamment occidentales, ont parfois tendance à penser que les organisations internationales sont leur chose. Cette idée est fausse et dangereuse car elle conduit à manipuler l’ONU pour assouvir des intérêts particuliers. La désastreuse intervention de l’OTAN en Libye en 2011 en fournit un bon exemple. Les pays du Sud peuvent se référer aux textes fondateurs de ces organisations, souvent bien écrits et bien pensés sur leurs missions fondamentales, pour faire constater les dérives lorsqu’elles ont lieu. Car, malgré tout, ces institutions remplissent des fonctions et des missions indispensables pour tous et notamment les pays du Sud. Alors que les menaces de guerre d’envergure s’accumulent, il est primordial de retrouver les chemins du dialogue au service de la paix. L’une des revendications les plus importantes à soutenir est la réforme de l’architecture financière internationale, outrageusement dominée par les pays occidentaux. Cette revendication avance, lentement certes, mais elle avance comme la montré le texte adopté au sommet de l’avenir à l’ONU en septembre dernier.
Après plus d’une année de destruction de Gaza, les Institutions internationales ont échoué à faire arrêter le massacre. Cela ne signe pas tout simplement leur arrêt de mort ?
Malgré l’impossibilité pour l’ONU d’imposer l’arrêt des massacres à Gaza – impossibilité due au comportement fautif des Etats-Unis – l’ONU agit sur le terrain et prodigue, autant qu’elles le peuvent, aide et soin aux populations. Plusieurs centaines de ses agents ont même trouvé la mort sous les bombements israéliens depuis le début de la guerre. C’est la preuve du courage et de l’engagement de l’ONU. En outre, l’Assemblée générale de l’ONU soutient l’Etat de Palestine et lui offre une tribune mondiale pour plaider sa cause. Au printemps, elle a – contre l’avis des Etats-Unis – accordé à la Palestine un statut renforcé lui permettant de siéger parmi les 193 membres de l’ONU, de prendre la parole et proposer des sujets de discussions. L’ONU remplit ici une fonction très utile de reconnaissance internationale et de tribune. Elle favorise l’évolution des rapports de forces mondiaux. Les votes au sein de l’Assemblée générale montrent souvent désormais l’isolement de l’Occident et la montée en puissance des pays du Sud qui s’affirment sur la scène mondiale. Les institutions conservent leur utilité dans ce monde chaotique car elles servent toujours de cadre à la coopération internationale : l’Assemblée générale de l’ONU travaille en ce moment sur l’intelligence artificielle (partage des technologies, lutte contre les discours de haine, etc.) et sur la protection des océans (traité international). Même le Conseil de sécurité parvient à adopter des résolutions, par exemple sur Haïti.
En revenant sur la création exceptionnelle de l’ONU et les idéaux qui ont présidé à sa fondation, quelles leçons pouvons-nous tirer pour réinventer de nouveau le droit international dans un monde particulièrement fragmenté ?
En 1945, les États-Unis, grande puissance vainqueur de la seconde guerre mondiale, aurait pu se contenter d’imposer d’une main de fer leur volonté sur le monde, quitte à s’arranger avec l’URSS. Ils ont estimé nécessaire de créer de l’ONU et donc un cadre international avec des institutions et des règles communes. C’est une preuve que les intérêts bien compris d’un Etat surpuissant peuvent le conduire à des décisions intelligentes au service de l’intérêt général. C’est cet esprit, à la fois pragmatique et idéaliste, qu’il faut retrouver aujourd’hui. Le droit international, imaginé en 1945, est équilibré et respectueux de la souveraineté des pays, y compris des pays émergents. Il forme un cadre, une sorte de code de la route, indispensable à la régulation internationale. Il ne s’agit donc pas de le réinventer mais de véritablement l’universaliser, c’est-à-dire en faire un outil pour tous. A ce titre, la procédure lancée par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice au nom de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à Gaza, illustre ce potentiel universel du droit international. Les logiques de forces, portées aujourd’hui par les grandes puissances doivent être combattues au nom du contrat moral passé en 1945 sur les décombres de la seconde guerre mondiale et de son potentiel libérateur qui accompagna, entre autres, la décolonisation.