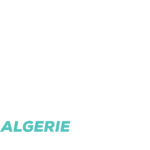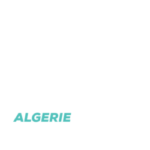Rencontré au Salon International du Livre d’Alger, l’historien italien Andrea Brazzoduro a longuement échangé sur la portée historique et politique de la Révolution algérienne. Spécialiste des mémoires coloniales et des sociétés post-décoloniales, il souligne combien l’expérience algérienne a marqué la conscience du XXᵉ siècle, bien au-delà des frontières du Maghreb. Dans cet entretien, il revient sur la place singulière de la guerre d’indépendance dans l’histoire mondiale, sur les nouvelles formes de colonialisme, et sur la manière dont les débats mémoriels continuent de traverser nos sociétés.
En quoi la Révolution algérienne éclaire-t-elle encore aujourd’hui notre compréhension du colonialisme ?
Je pense que la Révolution algérienne a été d’abord une étape fondamentale dans l’histoire contemporaine. Elle a marqué le début d’un regard lucide sur le passé, sur la manière dont les faits se sont réellement déroulés. La guerre d’Algérie s’inscrit dans le vaste processus des décolonisations, j’aime utiliser le mot au pluriel, pour rendre compte de la complexité de ce phénomène historique, sans doute le plus important de la seconde moitié du XXᵉ siècle.
Dans cette vague de décolonisation qui a bouleversé le visage du monde, l’Algérie occupe une place centrale : d’abord pour la nature particulière de la domination coloniale française, ensuite pour l’intensité et la durée du combat, enfin pour la portée internationale que le FLN a su donner à la lutte. Ce conflit a eu un retentissement mondial : il a inspiré d’autres mouvements de libération, jusqu’à la guerre du Vietnam, et a profondément marqué la conscience politique de toute une génération. On peut même dire que la Révolution algérienne a préparé le terrain à la contestation globale des années 1968, en contribuant à la politisation des sociétés occidentales.
Peut-on dire que le colonialisme a disparu, ou a-t-il pris de nouvelles formes aujourd’hui ?
Les phénomènes historiques évoluent : l’histoire, c’est toujours un jeu de continuités et de changements. Le colonialisme, s’il existe encore, ne prend plus les formes classiques qu’il avait autrefois. Il a existé sous diverses formes, depuis les Grecs jusqu’aux empires modernes, mais il s’est transformé au fil du temps. Aujourd’hui, on peut évoquer des formes contemporaines de colonialisme, notamment en Palestine, où l’on retrouve certains mécanismes typiques de la colonisation de peuplement : la volonté d’effacer une culture, d’effacer la mémoire d’un peuple avant même de s’en prendre à ses corps.
C’est une violence structurelle, spécifique, qui vise à détruire l’identité avant la matière.
Mais il faut toujours rappeler que le contexte n’est plus celui de 1954 ou de 1962 :
les équilibres internationaux ont changé, tout comme le rapport à la violence.
Dans les années 1950-60, la violence des colonisés pouvait être perçue dans un cadre révolutionnaire et politique précis. Aujourd’hui, cette perception n’est plus la même. Il y a des continuités, bien sûr, mais aussi des ruptures que l’historien doit reconnaître, sinon on tombe dans le « degré zéro » de la pensée historique. Comprendre le présent exige de nouveaux outils intellectuels et politiques.
Pourquoi les questions de mémoire continuent-elles de diviser jusqu’à nos jours ?
Le rapport conflictuel se situe plutôt du côté de la France. Là, la mémoire de la guerre d’Algérie est souvent instrumentalisée à des fins politiques. Ce n’est pas tant un problème d’histoire qu’un jeu politique, lié aux positionnements des deux pays sur la scène internationale. En France, la société semble traversée par une autre urgence : celle de questionner le racisme structurel, dans les institutions, à l’embauche, dans la police.
C’est cela, à mon sens, le véritable enjeu contemporain, bien plus que les querelles mémorielles. Quand on se promène dans les rues de Paris, de Marseille ou de Lyon, ce qui préoccupe les gens, ce n’est pas la mémoire de la guerre d’Algérie, mais les violences policières et la persistance des discriminations raciales. Le débat sur la mémoire détourne parfois l’attention de ces réalités brûlantes.
Un historien peut-il rester neutre face à une histoire aussi politique que celle du colonialisme ?
Mais qu’est-ce que cela veut dire, “rester neutre” ? L’historien, par définition, travaille sur les sources : il les analyse, les compare, les critique. Son rôle est d’élaborer des hypothèses et de les confronter à la réalité documentaire. Mais cela ne l’empêche pas d’être citoyen. Tant que la méthode historique est rigoureusement respectée, il n’y a pas de contradiction entre l’engagement personnel et le travail scientifique. Chacun peut avoir ses opinions, voter ou non, être de gauche, de droite, ou sans étiquette, cela n’affecte pas la validité du travail, pourvu qu’il soit méthodiquement fondé.
Le choix des sujets, en revanche, peut refléter une sensibilité ou une résonance avec le monde contemporain.
Étudier la préhistoire ou les luttes anticoloniales n’implique pas la même charge politique, mais il faut éviter les simplifications : toute recherche historique s’inscrit, d’une manière ou d’une autre, dans un rapport au présent.
Que représente, pour vous, la Révolution algérienne dans l’histoire mondiale des luttes d’indépendance ?
La Révolution algérienne occupe une place essentielle dans l’histoire des décolonisations.
Elle se situe à un moment charnière, peu après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où les anciens partisans antifascistes sont encore vivants et actifs.
Les contradictions de la domination coloniale française apparaissent alors dans toute leur intensité : une armée qui a combattu le nazisme se retrouve à mener une guerre coloniale, en reprenant les méthodes apprises en Indochine. Ce conflit a eu une résonance éthique et politique immense. Il a mobilisé des intellectuels, des militants, mais aussi une large frange de la société civile, bien au-delà des cercles de gauche. Des démocrates-chrétiens, des croyants, des artistes s’y sont reconnus. Cette dimension morale explique la profondeur de son impact dans les imaginaires collectifs. On la retrouve dans le cinéma, par exemple chez Paolo Pasolini, qui, dans son film La Rabbia, fait une référence explicite à la guerre d’Algérie, alors encore en cours. La Révolution algérienne fut un moment de basculement mondial, avant que le Vietnam ne prenne le relais symbolique. Enfin, il ne faut pas oublier le mythe de l’Algérie socialiste : dans les années 1970, de nombreux jeunes Italiens et Français partaient la découvrir, fascinés par l’expérience de l’autogestion et de la reconstruction.
Pour beaucoup d’entre eux, l’Algérie représentait le rêve du Tiers-Monde, non pas comme un lieu géographique, mais comme un projet politique et moral.
Comme le disait Pasolini, « le Tiers-Monde commence à la périphérie de Rome », une façon de rappeler que, partout, il existe un « Sud », et que la lutte pour la dignité traverse toutes les frontières.