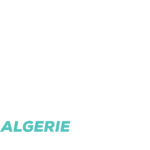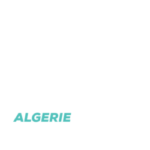La littéraire algérienne est riche de nombreuses publications et une maison d’édition comme Barzakh s’en fait la vitrine avec des choix graphiques pertinents pour chaque ouvrage publié. Dans ce cadre j’ai souhaité pour ma part réaliser l’interview de deux écrivains pour qui j’ai de l’admiration et un profond respect : Mustapha Benfodil et Samir Toumi qui chacun à sa manière dans la forme et le style nous parlent de l’Algérie contemporaine . Je vis en France et j’assiste avec enthousiasme à l’émergence de nouveaux écrivains dont le verbe fort nous parle quelque soit nos lieux de vie . En effet elle interroge sur la place de l’individu, dont le film Omar Gatlato s’en faisait l’écho en célébrant son émergence, mais cette littérature contemporaine interrogent aussi la société dans son histoire, ses contradictions, ses freins et sa vitalité .
Je n’oublie pas la tragédie qui se déroule aujourd’hui à Ghaza et en Cisjordanie et permettez moi de convoquer une écrivaine chére au coeur de Samir Toumi, Marguerite Yourcenar qui dans son roman les mémoires d’Adrien nous rappelait qu’il avait rasé « Jérusalem » (Al Qods), symbole tragique de l’effondrement des nations riches et puissantes .
Comment êtes-vous venu à l’écriture ? Est-ce qu’il y a eu un événement déclencheur ?
Mustapha Benfodil : Il est difficile de répondre avec précision à cette question dans la mesure où c’est l’auteur qui va aujourd’hui sur ses 57 ans qui répondra à la place de l’aspirant littérateur qui commençait à taquiner la muse au sortir de l’adolescence. C’est une aventure qui a commencé il y a une quarantaine d’années, et dont il n’est pas toujours aisé de démêler les pulsions primitives. J’ai une théorie qui me paraît à peu près honnête : je pense que l’élément déclencheur, ça a été la disparition brutale de mon père et de mes grands-parents paternels, qui se sont tous les trois éteints en moins de trois ans à Relizane entre 1974 et 1977. A l’échelle du gamin que j’étais – j’avais sept ans quand papa est mort – ce fut un véritable cataclysme. Ce n’était rien de moins que trois de mes piliers affectifs qui foutaient le camp. Cela a eu pour conséquence immédiate de m’amener très tôt, très jeune, à me poser les grandes questions, à m’interroger sur le sens de la vie et de la mort, sur la vulnérabilité de l’être… Et pour ne pas sombrer, j’ai rapidement trouvé refuge dans l’écriture, d’autant plus que j’étais un garçon timide et introverti, probablement à cause de ce traumatisme. Cela a commencé par une écriture de réflexion, de méditation, couplée à une écriture de confession sous forme de journal. Après, vers 17-18 ans, cela a évolué vers une écriture plus littéraire, qui s’exprimait par la poésie d’abord avant de s’étendre à l’écriture fictionnelle. Comme j’étais d’une imagination débordante, j’écrivais beaucoup d’histoires courtes, des nouvelles et des contes, marqués par la science-fiction et le fantastique car j’étais matheux et féru de sciences et d’astronomie. Le roman est arrivé dans la foulée, vers 1988-1989, et mon premier roman était inspiré déjà par l’actualité palestinienne puisque c’était le temps de la première intifada, celle qui était partie de Ghazza en décembre 1987. Mais ce roman est resté inédit.
Samir Toumi : C’est une question d’une redoutable complexité, car pour moi il n’y a pas eu de moment précis, pas d’événement unique qui aurait ouvert la voie. L’écriture s’est imposée très naturellement, presque comme une respiration. J’ai été un enfant lecteur, nourri très tôt aux livres : on m’en a mis entre les mains dès cinq ou six ans, sans doute même avant, avec ces petits ouvrages pour enfants qui éveillent déjà un imaginaire.
À l’adolescence, comme beaucoup, j’ai commencé à écrire pour apprivoiser ce trouble intérieur, ce mal-être diffus. C’était une manière de mettre en mots les premières interrogations existentielles : qui j’étais, quel chemin m’attendait, quel sens donner à ma présence sur cette terre. J’ai toujours eu, disons, une gravité d’enfant. Alors, mes premiers pas dans l’écriture sont passés par la poésie, puis par des textes plus élaborés, mais qui restaient du côté de la sensation, du ressenti, plutôt que de la description.
J’ai continué ainsi, sans jamais nourrir le projet clair d’écrire un roman ou de publier. Et puis, tardivement, à quarante-quatre ans, est venu *Alger, le Cri*. Dès la première ligne, j’ai eu la certitude que ce texte devait aller jusqu’au bout, qu’il devait être terminé, et qu’il devait trouver un éditeur. Je savais déjà lequel : les éditions Barzakh, avec qui le lien était évident.
Rétrospectivement, je m’aperçois que ce texte s’est écrit dans un moment de bascule. Je l’ai commencé en avril 2010, et la dernière ligne a été écrite le 14 janvier 2011, jour du départ de Ben Ali de Tunisie. Entre-temps, il y avait eu ces allers-retours constants entre Alger et Tunis, et sans doute une perception diffuse qu’un bouleversement se préparait. Certains disent que l’artiste est un paratonnerre, qu’il capte les signaux faibles de l’époque. Peut-être. Ce que je sais, c’est que ce livre tournait déjà autour de la quête d’une parole. Et la coïncidence de son achèvement avec le déclenchement des printemps arabes n’a fait que renforcer cette conviction : écrire naît toujours d’une urgence, d’un désir impérieux de dire. Et c’est bien cela, au fond, qui a toujours été mon moteur.
Vous êtes-vous posé la question de la langue ?
Mustapha Benfodil : Il s’est écoulé une bonne dizaine d’années entre mes « early works », autrement dit ma production littéraire de jeunesse, et la parution de « Zarta » (Le déserteur) en septembre 2000 aux éditions Barzakh, et qui sera ainsi mon premier roman publié. Jusqu’à la sortie de Zarta, j’avoue que je ne m’étais jamais posé la question de mon rapport à la langue et n’avais guère interrogé ce choix linguistique qui m’avait porté spontanément vers le français. Mais quand le roman est sorti, tout le monde me posait la question sur le sens de ce titre mystérieux et pourquoi un mot typiquement « francalgérien », « Zarta » étant une déclinaison algérianisée du verbe « déserter » (c’est un roman que j’ai écrit, je le rappelle, pendant mon service militaire, en 1997, à Sidi Belabbès). Au-delà du titre, tout le roman est écrit dans une langue mêlant allègrement l’arabe et le français. C’est vite devenu en quelque sorte ma marque de fabrique. Et je m’attache plus que jamais à incorporer dans mes textes de « graphie française » comme dirait Sénac, de l’arabe, à la fois darja et fos’ha. Il y a une dimension sonore dans mon écriture qui s’entend d’emblée, et que je travaille en amont. Il y a des plages d’oralité à travers lesquelles je m’évertue à dessiner des paysages sociaux et à restituer le foisonnement et l’inventivité de nos pratiques linguistiques en tant que production sociale du langage. Voilà comment j’essaie de me sortir du piège du français comme reliquat de la domination coloniale et comme langue système et véhicule idéologique souvent confondu avec l’infrastructure de la francophonie, pour permettre à mon identité profonde de respirer. Je ne conçois pas qu’on puisse écrire une oeuvre de bout en bout sans un mot de notre langue du quotidien. Je ne m’imagine pas écrire dans un français pur ; employer des onomatopées parigotes ou me complaire dans des coquetteries stylistiques germanopratines. Dans mon oreille tellurique, ça sonnerait faux. Ça manquerait de sel voire d’authenticité, et ça donnerait quelque chose de désincarné et d’artificiel.
Samir Toumi : La question de la langue, pour être honnête, n’est apparue que bien plus tard. Non, je ne me la suis pas posée au moment d’écrire, car ma langue d’expression littéraire naturelle a toujours été le français. Mes parents, comme beaucoup de leur génération, étaient francophones, et leur premier réflexe fut de m’ouvrir à la littérature par des ouvrages en langue française. Très tôt, j’ai trouvé dans cette langue une aisance, une fluidité qui ne m’étaient pas données de la même manière en arabe.
Ce n’est qu’après la publication de mon premier texte, au fil des rencontres avec des lecteurs, que la question a surgi, notamment à l’étranger. On me demandait pourquoi j’écrivais en français et non en arabe, quel était mon rapport à cette langue, et comment expliquer que certains écrivains algériens s’expriment en arabe, d’autres en français, d’autres encore en amazigh ou plus récemment, en darija et en anglais
C’est donc de l’extérieur que la question m’a été renvoyée. Et j’ai toujours répondu que je me définissais avant tout par un territoire littéraire : celui de l’Algérie. Avant d’être un écrivain francophone ou arabophone, je suis un écrivain algérien, inscrit dans le vaste corpus de la littérature algérienne. Pour moi, l’essentiel n’est pas la langue que l’on emprunte, mais l’identité littéraire, liée à ma culture, à mon parcours, aux thématiques que j’aborde dans mes textes.
Est-ce que le lieu physique où vous écrivez influence votre écriture ?
Mustapha Benfodil : Savoir dans quelle mesure le lieu ou la géographie où l’on écrit interfère avec l’écriture ? Je pense par exemple à une de mes pièces intitulée « Clandestinopolis », dont l’histoire se passe à Anvers, en Belgique. Ce choix n’est nullement anodin en ce sens que ce texte s’est beaucoup nourri d’un séjour que j’ai effectué il y a vingt ans dans cette ville. De manière générale, si l’action de mon roman doit se situer dans un lieu ou une ville ou un quartier précis, j’ai besoin d’y faire des repérages comme au cinéma avant d’y planter le décor de mon histoire. En ce moment, je travaille sur une nouvelle dont l’action se passe à Belcourt. Bien que je fréquente assidûment ce quartier puisque le siège d’El Watan où je travaille est au cœur de ce quartier, je suis parti dernièrement y faire des repérages pour visualiser l’immeuble exact où mon protagoniste habite et le paysage urbain alentour.
Samir Toumi : Au-delà du lieu, c’est sans doute la question du rituel d’écriture qui est fondamentale. Le lieu compte, bien sûr, mais il est inséparable de la manière dont on parvient à organiser son temps, à trouver un équilibre entre la vie professionnelle, la vie privée et cet espace singulier qu’est l’écriture. Car écrire suppose d’inventer pour soi-même des conditions, un rythme, une discipline presque intime.
Mon métier, très éloigné de l’univers littéraire – je ne suis ni journaliste ni professeur de lettres – m’a contraint à imaginer des espaces et des moments pour écrire. J’ai donc instauré mes propres rituels, parfois au domicile, dans le bureau de la maison, parfois dans mon espace professionnel où je m’octroie des instants pour me retirer et écrire, parfois encore dans certains lieux d’Alger, notamment des bibliothèques où le silence et la beauté du cadre nourrissent mon inspiration.
Je suis sensible à la quiétude, aux vibrations d’un lieu, à son esthétique. Ce sont autant de conditions invisibles mais nécessaires à l’élan de l’écriture. Ainsi, oui, la question du lieu – et plus encore du rituel – reste pour moi essentielle, une préoccupation quotidienne, presque un socle indispensable à l’acte d’écrire.