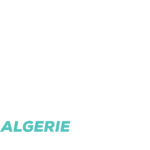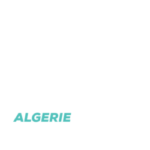Dans Mille histoires diraient la mienne, pubié en Algérie par les Editions Barzakh, l’historienne Malika Rahal tisse son enfance franco-algérienne à la grande Histoire : une photo d’oncle martyr, des petites annonces de 1962, un bourabah usé, une valise d’épices.
Entre pudeur familiale et rigueur scientifique, elle fait dialoguer les vivants, transforme la colère migrante en moteur de recherche et rappelle que l’histoire du temps présent est d’abord une aventure humaine : curieuse, émue, têtue, joyeuse.
Un livre qui relie les générations et prouve que transmettre, c’est déjà résister.
24H Algérie : votre livre, Mille histoires diraient la mienne, mêle histoire personnelle et familiale à l’histoire de l’Algérie contemporaine. Comment avez-vous navigué entre les deux registres, est-il difficile de trouver le juste équilibre entre le récit personnel et la rigueur de l’historienne ?
Malika Rahal : C’est venu assez naturellement, parce que pour une historienne, c’est un travail assez instinctif que de replacer les histoires dans leur contexte et de les comprendre dans leur complexité. En grandissant et en devenant historienne, certains épisodes que je considérais autrefois comme personnels, liés à l’histoire de ma famille, se sont transformés en éléments d’une histoire collective : celle de l’Algérie, bien sûr, mais aussi celle de la société française, et même des États-Unis. Je me suis rendu compte que ces récits participaient d’une mémoire commune.
Je me souviens par exemple d’une photographie, accrochée chez mes grands-parents : celle de mon oncle Zoheir, mort pendant la guerre d’indépendance. C’était pour moi un souvenir à la fois émouvant et mystérieux. Je n’osais pas poser de questions, alors que j’étais très curieuse. En grandissant, j’ai compris que cette pudeur existait dans beaucoup de familles algériennes. Partout, des photos semblables ornaient les murs. J’ai aussi appris que, comme mes grands-parents, d’autres familles avaient cherché à retrouver les corps de leurs disparus.
En questionnant mes oncles, j’ai découvert que mes grands-parents eux-mêmes avaient entrepris des démarches dans les années 1970 pour retrouver la tombe de Zoheir. Tout cela m’a montré que ce n’était pas une histoire individuelle, mais un fragment d’histoire nationale.
« Écrire l’histoire du temps présent, c’est dialoguer avec les vivants »
Votre travail s’inscrit dans l’Histoire du temps présent. Cette proximité avec les témoins influence-t-elle votre écriture ?
Toujours. C’est même ce qui définit l’Histoire du temps présent par rapport à l’Histoire contemporaine : les témoins sont encore vivants, ils peuvent être interviewés, vous lire, vous répondre. Cela change tout.
On écrit avec eux, pas seulement sur eux. Cela oblige à une vigilance, à une forme d’humilité : il faut leur laisser une place dans le récit. On a moins de pouvoir sur l’écriture, et c’est une bonne chose. Certaines de mes plus belles rencontres ont eu lieu ainsi, à travers ces échanges avec des témoins.
Avant la publication de mon livre, j’ai fait relire à certains les chapitres où ils apparaissaient. Ils m’ont parfois raconté de nouvelles choses. Ce sont des moments d’une grande richesse humaine.

« Être historienne, c’est aussi transmettre »
Peut-on dire que votre travail participe d’une transmission intergénérationnelle ?
Sans doute, oui. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu’un qui s’occupe du passé, et d’autres qui s’en détournent. Moi, j’ai choisi d’en faire mon métier, justement pour être certaine qu’il y ait de la transmission.
Être historienne de l’Algérie contemporaine, cela veut dire venir plusieurs fois par an ici, passer du temps, continuer à apprendre l’arabe — tant bien que mal — et poser des questions. Ce métier m’a donné le droit de poser des questions que je n’aurais jamais osé poser autrement. C’est une manière de surmonter la timidité et de relier les générations à travers l’écoute et l’écriture.
« L’émotion est un détecteur dans le travail de l’historien »
Comment les émotions personnelles nourrissent-elles votre recherche ?
L’émotion est souvent un détecteur. Elle signale qu’il se passe quelque chose d’important. Je me souviens d’avoir découvert un jour une collection de journaux de 1962. J’ai été bouleversée en lisant les petites annonces publiées juste après l’indépendance : des familles y cherchaient des disparus. Je ne savais pas encore quoi en faire, mais j’ai tout photographié. Des années plus tard, ces émotions ont donné naissance à deux projets : Algérie 1962, une histoire populaire et Mille Autres, un travail collectif sur les personnes enlevées pendant la guerre. L’émotion n’est pas une faiblesse. Elle oriente parfois la recherche.
Et puis, il y a une autre émotion : la colère. Grandir en France, dans une société qui a tant de mal à affronter son passé colonial, suscite forcément de la colère. Mais cette colère peut être motrice : elle pousse à chercher, à écrire, à débattre.
« Le ressentiment de l’enfant migrant »
Vous évoquez dans votre livre le “ressentiment de l’enfant migrant”. Que signifie-t-il pour vous ?
C’est ce sentiment d’avoir été privé d’une part de soi. Quand vos parents ont migré, ils vous ont donné une vie nouvelle, mais ils vous ont aussi, malgré eux, éloigné d’une langue, de vos grands-parents, d’un territoire familier, de culture, de senteurs…
On vit avec cette impression qu’il manque quelque chose — comme un membre invisible. Certains le ressentent plus que d’autres. Et beaucoup, aujourd’hui, cherchent à recréer ce lien perdu, chacun à sa manière : par des livres, des films, des recherches. Pour moi, ce manque est devenu un moteur.
« La quête de la langue arabe m’accompagne depuis l’enfance »
Cette quête du lien vous a-t-elle conduite vers la langue arabe ?
Oui, depuis toujours. Mon père ne m’a pas appris l’arabe, ni dialectal ni classique. Pourtant, aussi loin que je me souvienne, j’ai cherché cette langue. Je voulais la faire mienne. C’était une absence que je n’ai jamais acceptée.
Apprendre l’arabe en France n’est pas facile, mais j’ai saisi chaque occasion. La dernière fois, c’était l’été dernier, à travers un cours par Zoom avec l’université de Birzeit, en Palestine. C’étaient des moments très heureux : trois heures par jour, en pleine guerre, avec des échanges vivants avec notre professeure. Et je garde un souvenir lumineux de ses cours de grammaire. Je trouve la grammaire arabe d’une beauté et d’un réconfort immenses.
« Les objets du quotidien comme témoins de la mémoire »
Dans vos textes, vous évoquez souvent des objets du quotidien. Pourquoi cette attention particulière?
Les objets inutiles disent beaucoup. Ceux dont on ne se sépare jamais racontent souvent une histoire affective, familiale, invisible. J’ai, par exemple, un bourabah offert par ma belle-mère. Il est usé, on ne peut plus s’en servir, mais je le garde au bord de mon armoire, juste pour le voir. Il dit quelque chose de la transmission.
Je fais pareil avec les épices. Pendant le confinement, on me disait d’en acheter en France, mais je refusais : elles n’avaient pas le même goût, ni la même mémoire. Dès que j’ai pu revenir en Algérie, j’ai rempli une valise d’épices — au grand étonnement des douaniers ! Mais ces objets sont des morceaux d’identité.
« L’autobiographie, une manière de relier les mondes »
Pourquoi avoir choisi l’écriture autobiographique pour ce projet ?
J’aime beaucoup lire les autobiographies des autres. C’est un genre fécond, qui éclaire les œuvres sous un jour intime.
Je viens d’une famille trinationale — un père algérien, une mère américaine — et j’ai pensé que certaines anecdotes parleraient à beaucoup de gens, tandis que d’autres paraîtraient exotiques selon le regard.
Finalement, les lecteurs y trouvent chacun quelque chose de familier et d’étrange à la fois. Je n’étais pas sûre que cela intéresserait qui que ce soit en dehors des Franco-Américano-Algériens ! Mais les éditeurs ont eu raison : ce livre touche bien plus largement.
« L’histoire est une aventure, pas une discipline poussiéreuse »
Quel message souhaitez-vous transmettre à vos lecteurs et à vos étudiants à travers cette autobiographie?
Que l’histoire n’est pas une discipline figée, mais une aventure. Être historien, c’est être têtu, curieux, aimer les rencontres.
On ne parle pas seulement des morts : on raconte aussi les vivants. C’est un métier de contact, de transmission, de joie parfois.
Et surtout, ici, en Algérie, c’est un privilège. C’est un pays où la mémoire a une valeur, où la transmission compte.
Je veux dire aussi que notre histoire ne s’arrête pas à la colonisation ni à la guerre d’indépendance. Les décennies qui ont suivi — la construction de l’État, l’école, le socialisme, les années 1980 et 1990 — sont elles aussi pleines de sens et d’expériences à raconter. Il y a encore tant à éxplorer, à écrire et à décrire.