Abdelmadjid Chikhi, conseiller auprès du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, a révélé que le nombre des restes mortuaires de résistants algériens actuellement en France reste encore imprécis. « Il est vrai que des estimations ont été faites par un groupe de chercheurs, cependant le nombre demeure inexact. L’opération a été menée sur diverses périodes et a touché de nombreux Algériens. De surcroît, une bonne partie des restes mortuaires a été endommagée », a-t-il précisé dans un entretien accordé à l’APS,à la veille de la célébration du 66ème Anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. En juillet 2020, la France a restitué à l’Algérie les crânes de 24 résistants algériens, tués lors des premières années de l’occupation française, et conservés au Musée de l’Homme à Paris. Un hommage national leur a été rendu à l’occasion de la fête de l’indépendance le 5 juillet 2020. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé que les restes mortuaires d’autres résistants seront rapatriés à l’avenir « pour qu’ils soient enterrés sur la terre pour laquelle ils se sont sacrifiés ». « Après les massacres perpétrés en Algérie, la France a transféré les ossements des Algériens à Marseille pour les utiliser dans la fabrication du savon et le raffinage du sucre. Le sort d’une bonne partie des restes mortuaires demeure méconnu. Le travail doit donc se poursuivre dans ce sens », a déclaré Abdelmadjid Chikhi dévoilant un fait historique encore peu connu. En 2014, l’historien Moulay Belhamissi a révélé que des navires français chargés d’ossements provenant d’Algérie avaient déchargé leurs marchandises au Sud de la France quelques années après l’occupation.
L’Emir Abdelkader interdit la consommation du sucre blanc
« Pour du noir animal (charbon d’os) nécessaire à la fabrication du sucre, les ossements récupérés des cimetières musulmans étaient expédiés à Marseille. A l’époque, on réfuta les faits malgré les témoignages. Mais, l’arrivée dans le port phocéen, en mars 1833, d’un navire « La Bonne Joséphine », dissipa les derniers doutes. Des os et des crânes humains y furent déchargés », écrit-il. Dans le journal Le Sémaphore de Marseille, le Docteur Segaud écrit, dans l’édition du 2 mars 1833, avoir appris par « la voix publique » que parmi les os, qui servaient à la fabrication du charbon animal, se trouvaient ceux appartenant à l’espèce humaine. L’historien français Olivier Le Cour Grandmaison cite dans un livre le Docteur Segaud : « j’y ai vu des crânes, des cubitus de classe adulte récemment déterrés et n’étant pas entièrement privés de parties charnues. Une pareille chose ne devait pas être tolérée ». L’Emir Abdelkader aurait donné ordre à l’époque pour que le sucre blanc ne soit plus consommé en Algérie. « L’Algérie était considérée aux yeux du colonisateur français, comme un véritable champ d’essais pour mener des pratiques sauvages qu’il a eu à exercer, par la suite, dans d’autres colonies notamment en Afrique, où les autochtones ont pâti de la traite des esclaves dans laquelle ont été impliquées de hautes personnalités françaises. Toutes ces pratiques sont déposées dans les archives », a soutenu Abdelmadjid Chikhi avant d’ajouter : « Mettre à nus ces faits entamerait la notoriété de la France et l’image qu’elle tente de véhiculer comme étant un pays civilisé sous-tendant démocratie et respect des droits de l’Homme, et par conséquent elle a été contrainte, et souvent même, de fermer les portes des archives devant les chercheurs ».
« L’ensemble des archives sont pour nous une priorité »
Il a rappelé que l’Algérie continue de réclamer la restitution de toutes les archives sans distinction des épisodes de l’Histoire. « L’essentiel est de permettre à l’Algérien de s’enquérir de toute son Histoire(…) D’aucuns pensent que l’intérêt est porté, depuis l’indépendance, sur le combat du mouvement national lors de la guerre de libération, or la vérité est tout autre. Il n’y a aucune distinction entre les phases de notre histoire, elles sont toutes aussi importantes les unes que autres, dans le sens où il n’est pas possible de procéder à une écriture parcellaire de notre passé. Lors des négociations pour la récupération des archives, la partie française a tenté de faire perdre du temps en demandant à l’Algérie de fixer ses priorités dans cette opération, mais nous étions clairs à ce sujet. L’ensemble des archives sont pour nous une priorité », a-t-il détaillé.
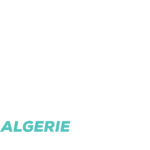











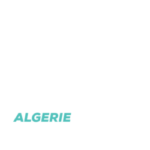




Il y a une différence entre quelques observations historique (non encore confirmée par la communauté scientifique) de chargements affrétés par des privés sans doute aussi autant d’autochtones que d’hexagonaux, menés par la cupidité extrême de certains humains et déclarer que l’État français et avec lui la France et les français ont organisé l’utilisation systématique d’ossement humain, ce que sous entend de façon totalement non subtile et non professionnelle l’historien en question. Comble de manipulation la comparaison avec le nazisme est à peine voilée. Elle est insultante pour les français et pour les algériens. Il est évident qu’attiser le feu en manipulant l’imaginaire algérien et saigner à blanc la sensibilité des algériens avec ce qu’ils sont et leur ancêtre est criminelle.
Faut pas prendre les gens pour des cons et surtout il ne faut pas manipuler l’Histoire dans le sens d’une guerre idéologique entre les gentils algériens et les méchants français, car dans le monde réel ça n’existe pas, il n’y a eu finalement qu’Histoire.
Il ne faut pas oublier non plus que dans cette guerre idéologique, les anciens qui tiennent le pouvoir on intérêt à faire diversion pour se maintenir au pouvoir, en héritier autoproclamé de la sainte révolution libératrice de ces horribles français qui mangeaient les petits enfants algériens et utilisait les os des humain pour faire du savon…..
Que c’est grotesque et surtout quel avenir pour une population chauffée à blanc par un imaginaire aussi moche et détestable, quel avenir serein envisager ? quel partenariat pour un monde renouvelé ? que faire de cette histoire entre France et Algérie si elle n’est vécue que sur le ton du scandale, de la barbarie, de la parodie du charnier et de la défécation mémorielle alors que la réalité est forcément ailleurs et sans doute pas aussi caricaturale.
Il faut tourner la page, sinon on reste des colonisés en esprit, toujours ramené à un récit de la colonisation sur le mode unique du cauchemar.
Le cauchemar existe rarement (dieu merci) et surtout on ne construit rien de bien avec du cauchemar. Moi je suis scandalisé que certains restent dans ce mode éternellement détestable dans l’abord du réel qui a été surtout principalement le réel de gens qui ont vécu et partager une histoire commune où des grandes choses ont été réalisées.
Il ne faudrait pas oublier le Beau qui est bien plus important que le crachat, l’insulte l’abjection, le charnier et la caricature.
Il serait bon de tourner la page un jour.
Enfin ce n’est que mon avis.
Signé :
Un français déçu par les réactions perpétuellement insultantes, caricaturales, nauséabondes et qui attend désespérément un avenir constructif avec un pays amis.